
Fil rouge N°10 (2001)
Histoire du syndicat de la Manufacture des tabacs de Dieppe, de 1891 à 1914.Histoire de luttes
Histoire de femmes
par Gilles Pichavant
Deuxième partie: 23 années de revendications et de luttes à Dieppe.
La première partie de cette étude a porté sur la création du Syndicat de la Manufacture des tabacs de Dieppe, le contexte historique et social dans lequel il se crée, le caractère de masse qu’il prend immédiatement.
C’est un véritable événement qui bouleverse le paysage dieppois, dans une entreprise d’État au personnel ouvrier quasi-unanimement féminin, où personne ne s’attend à l’apparition du phénomène syndical.
Rapidement les femmes vont prendre leurs affaires en main et cinquante ans avant d’obtenir le droit de vote, elle vont affirmer haut et fort, à l’aide du syndicalisme, leur revendication de la citoyenneté, en démontrant leur capacité à animer et à diriger une collectivité d’êtres humains.
Dès 1892, tentative de mainmise politique sur le syndicat.
L’année 1892 sera marquée par plusieurs assemblées du syndicat qui seront relatées dans la presse locale, plus particulièrement « l’Impartial ». Derrière l’apparente unanimité de la première réunion, il apparaît très vite que la création du syndicat bouscule une situation établie. Les choses ne sont pas aussi simples qu’il n’y paraît. En fait les milieux patronaux et réactionnaires ne se satisfont pas de l’existence d’un syndicat à Dieppe. La riposte s’organise.
Très vite, une campagne est orchestrée contre le syndicat et sa Fédération. Elle apparaît au grand jour sous la forme d’une mise au point du délégué de la Fédération, M. Repiquet, qui paraît le 30 avril dans « l’Impartial »: « Je suis accusé -1° d'avoir insulté, en pleine réunion en la salle du Gymnase, qui a eu lieu le mardi gras, tous les hommes syndiqués en les traitant de ... je donne le démenti le plus formel à ceux ou celui qui s'est permis d'écrire de pareilles choses au Comité Central et je m'en rapporte à tous ceux qui assistaient à la réunion. -2° que je cherche à faire tomber le syndicat que je suis venu former il y a dix mois, et que je veux renverser le bureau pour aller former un autre bureau composé rien que des ouvrières et laisser les ouvriers de coté;
C'est une pure imagination de la part des gens qui le disent, ceux qui douteraient de mes paroles, pourront demander la lecture de la lettre que j'ai adressée à Madame Letanneur, lettre qui portait la date du 10 avril dernier. Ils pourront apprécier mon opinion au sujet de la désunion que l'on me reproche.
J'ai toujours recommandé que les ouvrières étant en majorité, il fallait toujours les consulter avant de prendre une décision quelconque et c'est ce qu'on a oublié de faire. »
Cette première attaque vise deux objectif: premièrement s’attaquer à la place des femmes dans le syndicat et à la tentation qu’aurait la fédération de leur donner une trop grande place, et, deuxièmement, affaiblir le syndicat en contestant la démocratie syndicale.
Cette campagne prend appui sur l’inexpérience de la direction syndicale nouvellement élue comme sur l’éloignement géographique de la Fédération. Elle est vraisemblablement animée de l’intérieur même de la manufacture par une Direction qui cherche à profiter de cette faiblesse avant que le syndicat ne s’aguerrisse.
La véritable offensive va avoir lieu lors de la réunion des syndiqués convoquée le 18 mai 1892. C’est un véritable coup de force qu’on va tenter contre le syndicat pour l’affaiblir.
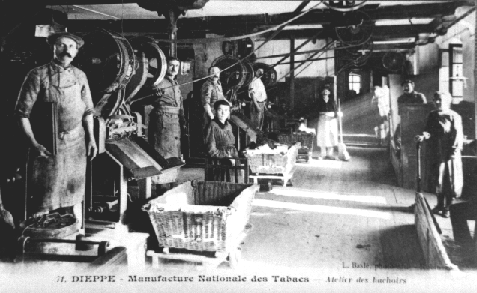
Ce jour là, le nombre des élus s’est sérieusement réduit par rapport à la réunion du 7 février. Aucun des députés ne s’est déplacé. Le Maire ne daigne toujours pas venir. Ce sont des conseillers municipaux qui sont présents. Il sont six.
Coté syndical, le secrétaire de la Fédération, Ducros, a fait le déplacement. C’est lui qui prend d’emblée la parole. Mais après le rapport qu’il présente, qui fait l’examen de la situation des revendications, l’attaque vient de la salle : on estime « qu'il eut été plus pratique que le syndicat créé à Dieppe fut simplement local ». Ainsi, après que certains aient développé l’idée qu’il était inutile de créer un syndicat à la manufacture, on tente la division syndicale. On cherche à peser sur le débat pour transformer le syndicat de Dieppe en syndicat autonome en le coupant de la Fédération. Mais l’assemblée repousse cette tentative.
C’est alors que deux autres élus M. Vincent et Roger s’en prennent directement au secrétaire de la Fédération sur le thème de ses sympathies politiques et mettent en accusation la Fédérations parce qu’elle serait favorable à l’emploi des travailleurs étrangers. « La question du socialisme international, agitée par M. Ducros, », écrit le journaliste de « l’Impartial », « a été combattue par M. Vincent et Roger. L'Etat, ont-ils dit, doit refuser d'employer des ouvriers de nationalité étrangère. M. Ducros a admis la théorie mais a déclaré ne pouvoir la mettre en pratique étant partisan du socialisme international. ».
Plus tard, les mêmes se permettent même d’user de leur autorité pour peser sur l’orientation du syndicat en proposant un amendement : « Le nouveau délégué a traité ensuite la question des retraites et il a proposé à ce sujet un ordre du jour à transmettre à nos députés. Après le vote de cet ordre du jour auquel MM. Roger et Vincent ont apporté un amendement concernant l'exclusion des ouvriers étrangers, la séance a été levée ».
Or il faut noter que MM. Vincent et Roger ne sont que des invités. Ce sont des conseillers municipaux qui n’ont aucun lien direct, ni avec la manufacture, ni avec le syndicat. Le premier est un élu d’opposition, élu sur la liste soutenue par le journal « la Vigie » ; c’est un élu fortement marqué à droite. Le second, un Avoué, élu sur la liste des « républicains », s’est, lors des précédentes élections municipales, prononcé pour le panachage entre les listes dites « réactionnaires » et « républicaines ».
Nous sommes donc en présence d’une pression extérieure, de caractère politique, qui vise à détourner le syndicat de ses objectifs. Il s’agit, en fait, de mettre un terme à son indépendance vis à vis des hommes politiques locaux et du patronat. C’était bien le risque de la stratégie mise en œuvre par la Fédération.
Cependant le syndicat tient bon dans l’épreuve. Il reste affilié à la Fédération, mais les débat vont bon train en son sein, à la manufacture et dans la ville. Un élément joue en faveur du maintien de l’affiliation, c’est le succès que vient d’obtenir la Fédération sur la question des retraites. Une élévation considérable du niveau des pensions vient d’être arrachée par elle.
Des dispositions sont prises pour suspendre provisoirement cette pratique d’invitation systématique des élus lors des assemblées générales. Elle reprendra cependant dès les années suivantes. Il semble que les élus ne se soient plus immiscés de cette manière dans les affaires du syndicat, et se soient limités à un rôle d’observateur.
Les retraites d’abord !
On l’a remarqué, la grande, la principale revendication du Syndicat des ouvriers et des ouvrières des tabacs de Dieppe, comme d’ailleurs celle des autres syndicats de la Fédération, c’est la retraite. L’article premier des statuts le proclame : « Notre but est d’arriver par tous les moyens possibles à l’augmentation de la caisse des retraites ». Et cette question occupe une grande partie des débats.
En principe, depuis 1861, les ouvriers des manufactures de l’État ont droit à une pension de retraite. Au départ, des cotisations avaient été prélevées sur les salaires, puis, en 1882, l’État les avait prises à sa charge.
Pour l’ouverture des droits, il fallait être âgé de 60 ans et totaliser trente années de cotisation. Mais on pouvait poursuivre son activité au delà de 60 ans afin d’augmenter sa pension.
En 1890, la pension pleine est établie à 400 francs par an pour un homme et à 320 pour une femme. Mais ces sommes, qui représentent environ un tiers du salaire annuel moyen, ne sont perçues que par une minorité des retraités. De nombreux ouvriers sont entrés trop âgés à la manufacture pour avoir assez d’années de cotisation arrivés à l’âge de la retraite. Il se retrouvent alors avec des pensions tout à fait dérisoires. Nombreux sont ceux qui subsistent avec moins de 100 francs par an.
Lors de la réunion du 7 février 1892, le délégué de la Fédération présente les revendications en matière de retraite : l’objectif est d’obtenir une retraite à 50 ans après 25 ans de travail, avec des pensions portées à 720 francs pour les hommes et 540 francs pour les ouvrières, soit environ 60% du salaire annuel moyen. La Fédération réclame aussi une retraite proportionnelle après 20 années de travail, sans condition d’âge, et après 15 années en cas d’infirmité
Le 15 mars 1892, elle obtient le relèvement des pensions à 600 francs pour les hommes et 400 francs pour les femmes soit une hausse de 50% pour les hommes et de 31% pour les femmes. Elle obtient aussi la garantie qu’il s’agit là de montants minimums, pour trente années de services et 60 ans d’âge. Ces dispositions sont fixées dans le règlement du 15 mars 1892, lequel concerne tous les ouvriers et ouvrières de l’État, tabacs et allumettes.
C’était un premier acquis. Mais les syndicats ne s’en contentent pas. Ils ont une bonne raison de demander avec insistance l’abaissement de l’âge de la retraite car la mortalité du personnel des manufactures des tabacs est effroyable. Certes « il y a un petit nombre qui arrivent à 60 ans. Mais à partir de cet âge, la mort fauche les rangs et très peu passent à la caisse pour toucher leur pension. La nicotine les a rayés des registres et porté leur inscription sur une tombe » peut-on lire dans « l’Écho des Tabacs », le journal de la Fédération en septembre 1897.
La crèche et le réfectoire.
La question de la crèche occupe presque autant de place que la retraite, dans les débats du syndicat.
Il en existe à l’époque dans plusieurs manufactures, mais c’est loin d’être le cas partout. A Dieppe, les ouvrières mères de jeunes enfants se font apporter leurs petits plusieurs fois par jour à la porte de l’usine. C’est là, sous le porche, qu’elles sont obligées, quel que soit le temps, de se découvrir pour leur donner le sein. D’autres interrompent leur travail à la naissance de leur premier enfant, ce qui crée une baisse importante des revenus de la famille.

Le syndicat demande qu’il y ait à l’intérieur de la manufacture, ou dans un local à proximité, une crèche bien aménagée, avec berceaux, chauffage et personnel approprié. Là, les ouvrières pourraient se rendre, sans perdre de temps, pour allaiter leurs nourrissons. C’est déjà le cas à Toulouse à cette époque.
A Dieppe, on ne se contente pas de réclamer une telle création auprès de la Direction, on se tourne vers la mairie. On profite de la présence des élus lors de l’assemblée pour le réclamer.
Le 7 février 1892, l’un des élus, Charles Delarue, conseiller d’arrondissement, annonce être déjà intervenu auprès de la direction sur la question de la création d’une crèche. Il déclare, « que le directeur de la Manufacture, le sympathique M. Duquesnoy, était tout disposé à faire son possible pour donner satisfaction à ce désidératum. Il en est de même pour la création d'un réfectoire. ».
Quelques jours plus tard, lors de la réunion du conseil municipal, il expose directement la revendication « des ouvrières de la manufacture des tabacs en ce qui concerne la création d’un crèche ». Il demande que le conseil émette un vœu en faveur de cette revendication. Le maire déclarait que c’était à l’État seul de prendre cette décision. Cependant le conseil émettait un vote unanime dans ce sens qui sera d’ailleurs sans lendemain.
Dès 1893, des crèches sont mises en place à Riom et au Mans, en 1894, à Châteauroux, en 1896 à Orléans. Puis se sera le tour de Nancy, Nantes et Bordeaux.
A Dieppe, la direction de la manufacture et la mairie se renverront la balle en permanence. Il faudra attendre les années 20 du siècle suivant pour que soit satisfaite cette revendication.
Quant au réfectoire il est en service depuis plusieurs années en 1902. C’est, en effet, dans la salle du réfectoire que les ouvrières viennent toucher leur paie de la semaine d’après le journaliste de « l’Éclaireur » de Dieppe, le 7 juin 1902.
La journée de huit heures et les congés payés.
Lors du 2e congrès de la Fédération en 1891, une nouvelle grande revendication apparaît : la journée de huit heures, avec « relèvement de salaire correspondant aux heures en moins », c’est à dire la réduction du temps de travail sans perte de salaire.
Les arguments ne manquent pas. La durée du travail est de dix heures de travail effectif par jour, onze en cas de « veillée », mais il n’y a aucun congé payé, chômage forcé pendant les inventaires. La Fédération met l’accent sur la deuxième journée de travail que les ouvrières sont obligées de recommencer en rentrant chez elles.
La pénibilité du travail et les risques liés à la manipulation du tabac sont des arguments qui sont employés en permanence pour revendiquer la journée de huit heures. En effet, les conditions de travail sont pénibles. Les ateliers sont insalubres. On est constamment exposé aux vapeurs et poussières nocives du tabac qui entraînent des troubles divers recensés par les médecins sous le terme de « nicotinisme ». Les effets toxiques du tabac entraînent une surmortalité chez le personnel des manufactures.
La Fédération s’appuie aussi sur la popularité de la revendication de la journée de huit heures qui « est à l’heure actuelle la préoccupation constante des travailleurs du monde du travail ».
Enfin, les profits réalisés par l’État sur les tabacs on doublé en vingt ans. Les moyens existent pour satisfaire la revendication.
En 1898, cette question du temps de travail donnera lieu à un conflit dans la manufacture de Dieppe. Au mois de mai, la Direction de la manufacture décide de prolonger d’une heure la durée de la journée du travail dans le cadre de la mise en place d’une veillée. La durée du travail s’en trouve portée à 11 heures au lieu de 10. A l’époque, les heures supplémentaires n’entraînent aucune majoration du salaire horaire.
Il en résulte une certaine effervescence dans la manufacture. Cependant la riposte met un certain temps à se concrétiser, bien que la question de la grève soit dans toutes les têtes. Finalement dans les premiers jours d’octobre, la période d’allongement de la journée se prolongeant, le syndicat appelle ouvrières et les ouvriers à ne plus venir travailler pour les veillées. Il s’agit donc de faire une heure de grève par jour.
La consigne est massivement suivie. Un petit nombre d’ouvrières se rend tout de même à la manufacture. La Direction a, en effet, fait courir le bruit que ceux qui viendraient travailler le soir bénéficieraient d’une majoration de salaire. Le lendemain les non-grévistes subissent des remarques, des quolibets, voire des menaces de la part de leurs collègues qui ont massivement suivi les consignes du syndicat. La Direction décide de faire appel à la police municipale pour assurer la « liberté du travail ».
Le soir, cependant, tout reste calme et la police n’a pas à intervenir. Tout est d’autant plus calme que celles qui étaient venus travailler la veille ont découvert, pendant la journée, que la Direction n’honorerait pas ses promesses. Il n’est pas prévu de majoration exceptionnelle du salaire horaire. Aucune ouvrière ne vient travailler. La grève est donc totale. La direction cède et la durée du travail est ramenée à 10 heures.
Finalement, la force d’organisation et la combativité des ouvrières et des ouvriers des manufactures des tabacs va porter ses fruits. En 1905 leur journée de travail est limitée à 9 heures, mais la lutte continue pour les huit heures. En 1911, ils obtiennent 6 jours de congés payés par an, qui sont portés à 12 l’année suivante.
Et la décision sera prise que dès le 1er août 1914, ils bénéficieront de la « semaine anglaise » - grande revendication alors de la CGT -, c’est à dire de 49 heures de travail par semaine avec le samedi après-midi libre. Cependant le 1er août 1914, commence la première guerre mondiale.
Un conflit pour la levée d’une sanction.
Le jeudi 6 juillet 1899, en plein congrès de la Fédération, une grève commence dans le service d’empaquetage du tabac à fumer de la Manufacture de Dieppe, à l’occasion du refus de 272 paquets sur les 1000 préparés par le service. Les paquets n’avaient pas le poids réglementaire de 40 grammes .
C’est la mise à pied, prononcée contre l’une des ouvrières, qui met le feu aux poudres. Auparavant quand du poids manquait aux paquets de tabac, on obligeait les ouvrières à les refaire, sur leur temps personnel, pour toute punition. La mise à pied leur paraît être une sanction démesurée. Immédiatement les quarante deux ouvrières de l’atelier se déplacent auprès du Directeur pour réclamer la levée de la sanction. Celui-ci ayant refusé, vingt quatre ouvrières décident de ne pas reprendre le travail et de se mettre en grève. Elles informent la Fédération qui leur conseille de continuer la grève en attente d’une audience au ministère. Cependant le reste du personnel de la manufacture ne bouge pas. Il est partagé quant au soutien à apporter aux grévistes. Les grévistes sont désormais au nombre de vingt sept à poursuivre leur mouvement.

Mme Rosa Leroy, vice-présidente du syndicat, présente à Paris comme déléguée au congrès de la Fédération, obtient une audience au ministère des finances pour demander la levée de la sanction. Surprise! Le Ministre déclare qu’il n’a rien à faire puisque que le Directeur de la Manufacture de Dieppe lui a écrit qu’il n’avait pas appliqué la sanction. Cette déclaration du Directeur est évidemment mensongère.
L’information parvient à Dieppe le 11 juillet où le syndicat la rend immédiatement publique. La découverte du mensonge de la Direction choque le personnel et provoque la colère.
Dès 9 h 30, « six cents ouvrières syndiquées » descendent dans la cour de la Manufacture et obligent le Directeur à venir s’expliquer. Celui-ci cède sous la pression. Il transforme la sanction en « peine morale » en décidant que la mise à pied serait réputée effectuée le dimanche 16 juillet, jour de repos.
La grande grève de 1902 « contre le mérite ».
Le début du 20e siècle est marqué par une mémorable grève générale des ouvrières et des ouvriers des tabacs.
Il existe alors dans toutes les manufactures, un système de promotion fonctionnant au mérite, à l’aide d’un « tableau » dont le principe est de favoriser les ouvrières les plus habiles.
En effet, les salaires sont variables selon les positions de travail. Par exemple en 1899, les salaires sont les suivants : Séchage du tabac (femmes) 5,13 francs, confection des cigares (femmes) de 3,70 francs à 3,80 francs, apprenties cigarières de 0,60 francs à 0,90 francs, paquetage (femmes) 4,07 francs, employées au pesage 3,30 francs, vignetteuses 3,30 francs. Ce qui donne une moyenne de 3,10 francs pour les femmes, les hommes ayant un salaire moyen de 4,85 francs. On recherche donc les positions de travail les mieux payées ou les moins pénibles, les deux n’allant pas forcément ensemble.
Le classement des ouvrières sur le tableau se fait sur la base du nombre de rejets. Dans la pratique, le système s’est perverti. Il est devenu une technique permettant de favoriser certaines ouvrières au détriment d’autres - on dirait aujourd’hui « à la tête du client ».
« La Voix du Peuple », hebdomadaire de la CGT, datée du 15 juin 1902, précise : « Dans la pratique, à la réception, ce rejet est fait « selon les têtes » : telle ouvrière qui plaît n’aura pas de rejet. Tandis qu’une autre pourtant plus habile, mais plaisant moins, en aura. Il peut se produire aussi, même sans qu’il y ait la réception une arrière pensée d’injustice, qu’une ouvrière excessivement habile (…) ait dans la quantité quelques cigares moins parfaits et qui seront rejetés ; au contraire, une ouvrière médiocre, mais produisant une marchandise uniforme, n’aura pas de rejet. Et cette dernière sera classée avant l’autre. »
La grève commence dans la deuxième quinzaine de mai 1902, à la manufacture de Reuilly, spécialisée dans la fabrication de cigares de luxe. La Direction y teste une machine dans le but d’automatiser la fabrication des cigares. Mais l’expérience s’avère désastreuse pour la qualité. Cependant les cigares sont tous acceptés par « la réception » ce qui favorise les ouvrières qui travaillent à la machine où elles ont été placées « par piston ».
Les protestations se multiplient, mais la direction fait la sourde oreille. On trouve dans un journal de Dieppe « L’éclaireur » daté du 7 juin 1902, la position de la Régie des tabacs. Elle défend l’idée que la mise en œuvre d’un système à l’ancienneté « ne peut pas l’être, (..) parce que les progrès de la science industrielle sont constants ; les procédés changent ; Les machines perfectionnées se créent tous les jours et les ingénieurs ont pour devoir d’utiliser les moyens de production qui sont toujours plus économiques ». La modernisation contre le social ; c’est un discours qui change peu, vous ne trouvez pas ?
A la suite de ce communiqué, le journaliste précise la problématique : « Seulement, pour en tirer complètement parti, » - des moyens de production toujours plus modernes - « l’administration est amenée à s’adresser à un personnel jeune, délaissant ainsi les ouvriers et les ouvrières dont les aptitudes ont baissé, dont la souplesse physique – qualité absolument précieuse en la circonstance – est moins grande que celle d’équipes qui n’ont pas les années de service, et qui se trouvent ainsi les distancer dans les avancements ». (…) « Il semble injuste aux ouvriers et aux ouvrières âgées, et il y a un peu d’injustice dans la manière de récompenser les services rendus ». C’est donc tout un système qui est en cause. Deux conceptions de la gestion comme deux conceptions de la modernisation, s’affrontent.
Dans le numéro du 8 juin de « La Voix du Peuple », l’éditorialiste confirme les raisons de la vague de fond qui déferle: « Peu importe les longues années de labeur de certaines ouvrières ; peu importe les maladies contractées à manipuler la substance toxique qu’est le tabac… Après ces années de dur labeur, après avoir usé sa jeunesse pour produire de plus gros bénéfices à l’État, au moment où l’ouvrière, fatiguée avant l’âge et mère de famille, aurait besoin de gagner un peu plus –ne serait-ce que pour soigner son organisme délabré par une production intensive – elle est dédaignée. »
Cependant les raisons semblent bien plus profondes encore : Le journaliste de « La Voix du Peuple » poursuit : « Un tantinet d’avancement lui est dû, mais les gardes-chiourmes lubriques veillent (…) Ces individus ont, comme les satyres de la mythologie, jeté des regards pervers sur les femmes et les filles du peuple : de l’avancement et subir mes caprices, ou conserver l’honneur et la servitude ».
Exagération de journaliste ou de syndicalistes ? Pas sûr ! On trouve, en effet, trace de ce qui serait appelé aujourd’hui « harcèlement sexuel » dans un article de « l’Impartial » de Dieppe paru le 30 octobre 1900. Il s’agit du compte rendu d’une assemblée du syndicat de Dieppe, tenue deux ans avant cette grève : « (…) Mme Mathieu prend ensuite la parole et fait un tableau de ce qu'était le sort de ces anciennes ouvrières avant le syndicat. –« Une discipline de bagne, de maison de correction, un enfer en un mot . Elle fait le procès d'un ancien chef de section dont elle ne cite pas le nom. Elle dit les mauvais traitements auxquels il soumettait les ouvrières. –« Il faut, » s'écrie-t-elle, «que les mères de famille disent si elles veulent voir leurs filles devenir la proie de messieurs de ce genre sans pouvoir se plaindre ». Non répondent ensemble toutes les assistantes. ».
Le mécontentement enfle donc. Le « ras-le-bol » est profond. A Reuilly le syndicat de la manufacture intervient auprès de la direction et faute de satisfaction, la grève est préparée. Elle est d’abord votée à bulletin secret, puis les ouvrières signent la décision prise. Quarante huit heures plus tard, la grève commence. Elle s’étend très vite au deux autres manufactures parisiennes, qui bénéficient pourtant, déjà, de l’avancement à l’ancienneté, et donc ne semblent pas être directement concernées. Puis la grève gagne l’ensemble des manufactures, dont celles du Havre et de Dieppe.
La grève est massive dans toutes les manufactures. Dans certains endroits elle est générale. Elle reste cependant partielle à Dieppe, où elle commence le 5 juin avec 250 grévistes, le chiffre atteindra les 320 personnes le samedi 7 juin. Mais la grande majorité du personnel ne bouge pas. Cela semble être la même situation au Havre où des altercations ont lieu entre grévistes et non-grévistes.
Tout au long du mouvement les grévistes dieppoises se réunissent dans la salle municipale des « Bains Chauds » située rue Victor Hugo, près de la Mairie. Pour se faire payer des salaires qui leur sont dus, les grévistes au nombre de 300, se rendront en cortège de cette salle à la manufacture en passant par la Grand-Rue, vers 15 heures le samedi après-midi. C’est un événement très exceptionnel pour l’époque.
Cependant le gouvernement reconnaît bientôt qu’il y a 66% de grévistes sur l’ensemble de la Régie.
Le 10 juin, tout le monde peut reprendre le travail. La veille, le ministre avait reçu les délégués du comité fédéral et leur avait promis qu’un règlement sur la base de l’ancienneté allait être mis à l’étude. Il faudra encore quelques années de luttes pour que celui-ci voit le jour sous une forme acceptable, mais, ensuite, ce règlement régira le personnel des manufactures de tabacs pendant trois quarts de siècle.
Évolution des effectifs syndiqués de 1891 à 1914
Le syndicat de la manufacture, affilié à la CGT dès la création de celle-ci en 1895, sera toujours un syndicat de masse, du moins durant la période qui concerne notre étude, c’est à dire de 1891 à 1914.
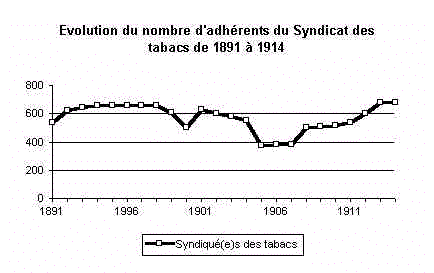
On peut constater plusieurs périodes dans la vie de ce syndicat :
La première est celle de la constitution du syndicat. Après avoir commencé avec 540 syndiqués, dont 500 femmes et 40 hommes, l’effectif dépasse, dès 1894, les 650 syndiqués sur 900 salariés, effectif qu’il conserve jusqu’en 1898.
On peut noter un repli à partir de 1899: 609 syndiqués en 1899 puis 500 en 1900. Faut-il y voir la conséquence de la « prise de pouvoir » par les femmes dans le syndicat ? Le bureau et le conseil syndical sont, en effet, entièrement composés de femmes à partir de cette époque. Les hommes ont disparu. Faut-il y voir la conséquence de l’existence d’un second syndicat, autonome celui-ci ? Le « Syndicat des préposés de la manufacture des tabacs de Dieppe » existe depuis 1897. C’est un syndicat très corporatif. Il est composé des contremaîtres et surveillants qui l’ont créé pour « arriver à fixer d’une façon régulière les différentes classes de leur emploi ». Il ne dépassera jamais les 21 personnes. En 1900, dernière année de son existence, il avait 16 adhérents : 3 femmes et 13 hommes. En 1901, ce syndicat se dissout, mais persiste le besoin d’une représentation spécifique de ce qu’on appellerait aujourd’hui les agents de maîtrise et cadres. Une organisation nationale, « l’Association générale des préposés des manufactures et magasins de l’État » se crée en 1903 dans le cadre de la « loi 1901 ». A Dieppe, elle sera représentée sous la forme d’une « amicale ».
En 1901, le Syndicat des ouvriers et des ouvrières de la manufacture des Tabacs a de nouveau plus de 600 syndiqués : 628 exactement, dont 600 femmes et 28 hommes. Cependant les effectifs rechutent progressivement les années suivantes : 600 en 1902 puis 580 en 1903, 550 en 1904.
En 1905, c’est l’effondrement à 375 syndiqués, suivi d’une stabilisation à 385 les deux années suivantes. Il est à noter que ce sont les années où la durée du travail a été fixée à 9 heures par jour dans toutes les manufactures. Cette réduction du temps de travail aurait-elle été mal perçue ? Ce serait étonnant car les ouvriers ont obtenu un relèvement proportionnel des salaires. La baisse des effectifs semble due à un autre phénomène, peut-être à l’existence d’une structure concurrente de type « association loi 1901 », mais les données en notre possession ne nous ont pas permis de le découvrir. Il est à noter cependant que, durant la même période, le nombre total de grèves régresse en France jusqu’en 1908, pour progresser à nouveau en 1909 et 1910.
A partir de 1908, les effectifs du syndicat se remettent à progresser régulièrement. De 500 syndiqués en 1908, ils atteignent 680 en 1914. Sans doute faut-il y voir là l’effet de la satisfaction de revendications.
Enfin il est à noter que le 8 novembre 1812, se créée le « Syndicat des ouvriers de la Manique ». Syndicat autonome, qui est exclusivement masculin et compte 20 adhérents. Après le « Syndicat des préposés de la manufacture des tabacs de Dieppe », puis celle de « l’Amicale des préposés », la création de ce nouveau syndicat met en évidence que l’unité syndicale n’est pas une chose naturelle.
L’unité est un combat. Même à cette époque où sa force semble incontournable et où toute division est assimilée à une trahison, la place des minorités – une première fois la maîtrise, puis les ouvriers masculins – est posée. L’expression et la défense toutes les revendications, sans exclusive aucune, dans le cadre d’un fonctionnement démocratique, ne peuvent être qu’une préoccupation permanente de l’organisation syndicale si celle-ci veut surmonter les forces centrifuges qui la menacent.
Après une période près de dix ans d’absence de militants masculins, des hommes réapparaissent à partir de 1908. Le poste de secrétaire sera confié périodiquement à un homme en la personne de M. Seille. Cependant les femmes conserveront les postes de présidente et vice-Présidente.
Un syndicat ça change les chose énormément !
Nous avons survolé la création et la vie du syndicat des ouvriers et des ouvrières de la manufacture des tabacs de Dieppe en essayant de les relier à la vie de la Fédération et à la vie de la CGT, mais aussi de la vie locale à Dieppe. Nous avons été amenés à nous limiter à certains aspects de la vie syndicale, et à laisser de coté certains points, comme la question de la lutte pour obtenir des droits nouveaux et des libertés syndicales, ou celle pour l’emploi, qui émaillent pourtant la période.
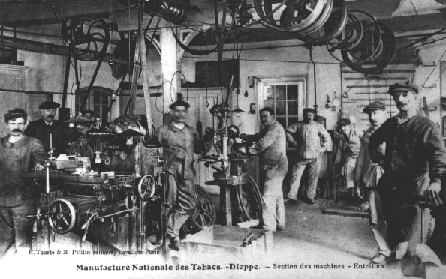
Pour parvenir à écrire cette étude, nous avons essentiellement utilisé la presse locale et les archives départementales de Seine-Maritime comme principales sources, les archives du syndicat ayant disparu. La presse locale, essentiellement « l’Impartial », est particulièrement riche.
Il est un article, dont nous avons déjà utilisé un élément, qui est particulièrement éclairant du point de vue de ce qu’un syndicat peut faire changer pour des salariés, au quotidien, dans une entreprise. Paru dans « l’Impartial » le 30 octobre 1900, il fait un retour en arrière sur neuf ans d’activité. Le journaliste restitue le tableau, brossé par les militantes, de ce que son existence a changé pour elles.
« Mme Mathieu prend (…) la parole et fait un tableau de ce qu'était le sort de ces anciennes ouvrières avant le syndicat. –« Une discipline de bagne, de maison de correction, un enfer en un mot ». (….)
« Mlle Leroy reprend la parole pour célébrer les bienfaits de neuf années de syndicat. –« c'est à lui qu'on doit les indemnités en cas de blessures, coupures, etc. ; indemnités cependant minimes, car il faut compter obtenir plus dans l'avenir. » (…) « Il y a neuf ans, quand vous voyiez entrer un chef de section, vous changiez de couleur »- « OUI » - Si c'était le directeur, vous perdiez la tête » - « OUI » - « Depuis le Syndicat, avez vous peur de quelqu'un? » - « NON, de personne » - « Voilà la différence ! »
« Un jour que j'avais parlé, un préposé, un des anciens dont on parlait tout à l'heure, me fit faire la faction avec un balai dans le couloir(…). Quelques femmes se souviennent d'avoir travaillé debout, en punition, et quand, après deux heures de travail impossible, elles tiraient leur tiroir pour s'appuyer, c'était encore deux jours. Le syndicat a supprimé toutes ces tortures, aussi faut-il s'efforcer de sauver son action bienfaisante ».
Hier comme aujourd’hui, l’existence d’une organisation syndicale au sein d’une entreprise ne se mesure pas seulement aux résultats mathématiques et comptables de la satisfaction ou non de telle ou telle revendication. L’existence même d’un syndicat change tout. C’est toute la vie qui change. C’est la dignité et le respect que l’on découvre. C’est l’égalité de traitement qui s’arrache.
En guise de conclusion
« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » a dit le poète. A un siècle d’écart, on reste frappé par l’extraordinaire actualité des problématiques syndicales posées par la vie de ce Syndicat de la manufacture des tabacs de Dieppe, exhumée des archives et oubliée par l’histoire.
Elle met en perspective le combat toujours recommencé des syndicalistes, que l’on qualifie souvent d’utopistes, contre les « pragmatiques » tenants de l’ordre ancien.
De la retraite, en passant par la réduction du temps de travail, du refus des « systèmes au mérite » aux batailles pour l’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de travail, de celles pour les libertés syndicales et la dignité, n’est-ce pas, en définitive, le combat des modernes contre les archaïques? En travaillant à l’histoire nous travaillons à l’avenir.